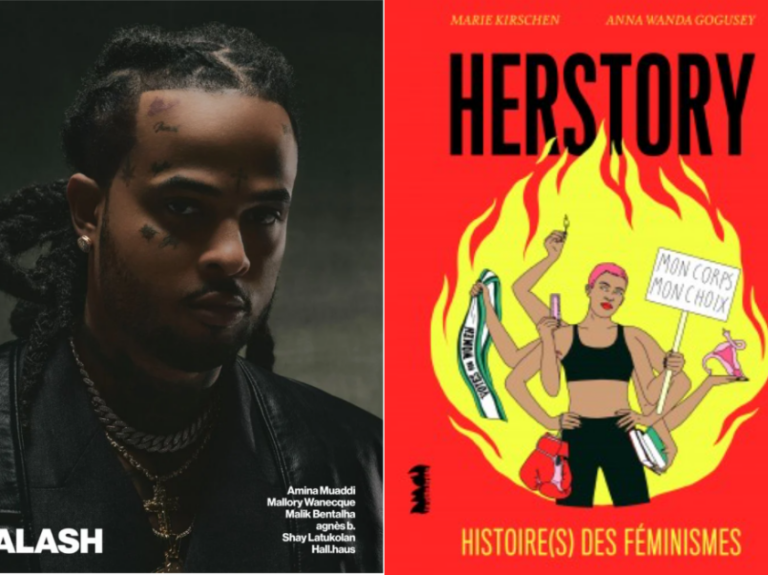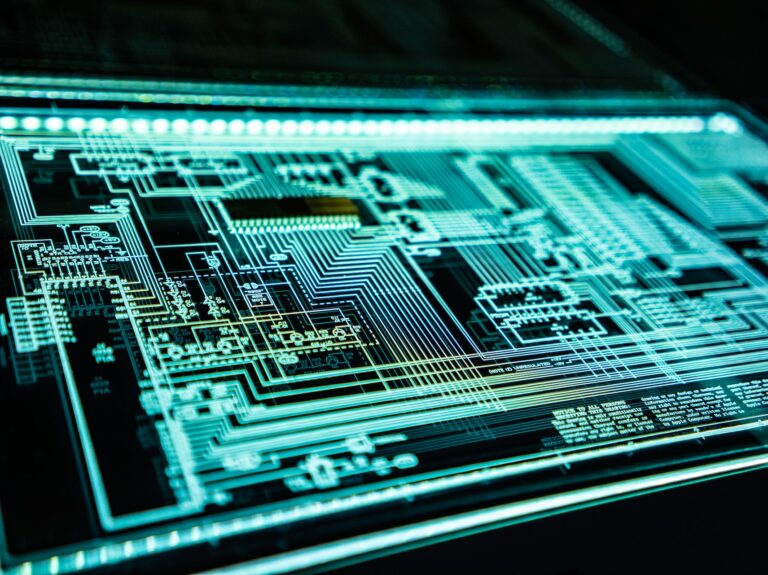Vincent Canchon : « Écrire n’est ni une question de temps, ni de patience, mais de désir »
Des dirigeants d’entreprise qui écrivent des livres, ça court les rues. Mais lorsque l’un d’entre eux prend la plume non pas pour parler de management ou de gestion, mais pour écrire un pur roman, mêlant sens de l’intrigue et travail orfèvre de la langue, c’est pour le moins inattendu. Avec Ce qu’a tu le vent d’Ouest, publié aux éditions Gallimard, Vincent Canchon, Directeur général de Square, nous propose une œuvre virtuose, atypique et marquée par une véritable ambition littéraire.

Comment vous êtes vous lancé dans l’écriture de cet ouvrage ?
Si Ce qu’a tu le vent d’ouest est mon premier roman publié, il n’est pas le premier que j’écris ! Dès mon plus jeune âge j’ai toujours été attiré par les mots. Je griffonne mes premiers textes à l’école primaire, où j’avais notamment imaginé une suite aux aventures de Tintin et le crabe aux pinces d’or. J’ai ensuite continué durant mon adolescence : écriture de scénarii pour des jeux de rôles, poèmes, nouvelles… J’avais un besoin constant de coucher des mots sur le papier, raconter des histoires, sans nullement savoir où cela me mènerait. Au début de ma vie professionnelle, j’ai rédigé un premier roman — celui qu’il faut commettre avant de prendre le grand large, truffé d’éléments autobiographiques, donc —que je ne fis lire qu’à un petit cercle d’amis. Puis je me suis lancé dans l’écriture de ce qui deviendrait Ce qu’a tu le vent d’Ouest.
Comment s’est déroulée l’écriture ?
J’ai vécu dix années assez difficiles, avec le sentiment d’être complètement à côté de la demande dominante. Dans les librairies, les livres bénéficiant de critiques enthousiastes me semblaient très éloignés du mien. Je portais un texte qui semblait à rebours des modes du moment. J’ai continué d’écrire en me disant que je travaillais « en vue de jamais », comme l’eût dit Mallarmé, sur un texte qui n’avait pas la moindre chance d’être publié. La mort de mon père, en avril 2020, a été un déclic : je me suis dit qu’il fallait que j’en fasse quelque chose. Je me suis donc décidé à l’envoyer à quelques maisons d’édition. J’ai reçu 8 réponses positives, parmi lesquelles, celle de Gallimard, dont le niveau de perception, de compréhension, d’interprétation était de loin le plus abouti.
Comment fait-on pour allier vie de chef d’entreprise et vie de romancier ? Où trouve-t-on le temps d’écrire ?
Je crois que ce n’est ni une question de temps ni de patience, mais de désir. Lorsque l’on est porté par ce désir d’écrire, le temps se trouve. Julien Gracq disait qu’il [était] aussi rare de se passionner pour un roman que de tomber amoureux ». Je trouve la comparaison très juste. Et c’est, me semble-t-il, l’état dans lequel doit nécessairement se trouver l’écrivain pour écrire quelque chose qui vaille la peine. Je tiens d’ailleurs à louer la patience de ma famille, de mes proches, car ce n’est pas facile de vivre avec quelqu’un qu’habite une idée fixe. On vit dans un état d’obsession constant. Écrire est certainement l’expression d’une liberté, mais c’est une liberté qui a un prix, implique une certaine forme d’aliénation. C’est le travail d’une fourmi rongée par le doute, que l’on ne peut bien mener qu’en rupture. « La solitude accompagne nécessairement cette espèce d’attitude », pour reprendre une fois encore les mots de Mallarmé.
Quelles sont vos principales influences littéraires ?
J’ai un petit panthéon qui se compose de Chateaubriand, Conrad, Gracq, Proust…, auxquels s’ajoutent des écrivains plus récents comme Pierre Schoendoerffer, Pascal Quignard ou Philippe Le Guillou. Quand je me suis lancé, je souhaitais évidemment écrire quelque chose qui ressemblât à ce que j’aimais lire, retrouver la propension magique qu’ont certains textes à susciter la rêverie. Ne pas comprendre une phrase, devoir la relire plusieurs fois, ne me pose aucun problème dès lors qu’elle m’offre, comme Debussy le désirait lui-même, la possibilité « de greffer mon rêve sur [celui de l’auteur] ». Si les lecteurs pouvaient – ne fût-ce qu’un instant – vivre une expérience semblable en parcourant mon livre, ce serait une immense satisfaction.
Pensez-vous que les Français ont (re)pris le goût de la lecture avec les différents confinements ?
Je suis heureux de vivre dans un pays pour lequel la littérature semble encore compter. Les témoignages des libraires que j’ai rencontrés montrent cet appétit des lecteurs. Mon souci est de parvenir à faire entendre une voix un peu différente. Montrer qu’on peut écrire quelque chose de parfaitement moderne dans « une langue qui ne renie rien » (J.M. Delacomptée), ne renonce à aucun des « tout puissants accords de [sa] riche musique… », pour paraphraser Baudelaire. Il ne viendrait à l’idée de personne d’expliquer à un compositeur contemporain qu’il fera bien de se passer du fa dièse ou du mi bémol au prétexte que l’oreille des auditeurs y est mal habituée ! C’est la même chose pour le passé simple ou l’imparfait du subjonctif : au-delà de leur intérêt grammatical, leur seule valeur sonore offre aux romanciers des ressources musicales dont je ne conçois pas qu’on puisse se priver.
Au royaume de l’image, le roman vous paraît-il conserver un avenir ?
Je lisais récemment à propos du dernier ouvrage d’un auteur à succès « qu’il se dévorait comme une série ». Mais si l’avenir du roman est d’être dévoré comme (par ?) une série, que lui restera-t-il ? Le roman, je crois, doit être capable de toucher des régions de l’âme qui diffèrent de celles qu’espèrent combler les séries télévisées. La littérature me paraît avoir de beaux jours devant elle, si, comme art, elle continue à cultiver ce qui lui est propre — et ce qui lui est propre, avant l’image, avant l’idée, ce sont les mots !